Rédacteur, reporter, présentateur radio, journaliste web… le journalisme regroupe une multitude de métiers passionnants. Qu’il s’agisse de couvrir l’actualité internationale ou d’écrire pour un magazine culturel, ces professionnels partagent une même mission : informer le public. Vous envisagez une carrière de journaliste ? Dans cet article, nous passons en revue les différents métiers du journalisme, les études et formations pour y parvenir, ainsi que les débouchés et conseils pour réussir dans ce domaine exigeant.
Les étudiants se pose souvent de nombreuses questions : Quelles sont les missions d’un journaliste ? Quelles études faut-il faire ? Est-ce un métier d’avenir ? Quels sont les avantages et contraintes au quotidien ? Nous répondons ici de façon claire et complète à ces interrogations, afin d’aider les lycéens et étudiants à s’orienter vers les métiers du journalisme en toute connaissance de cause. Suivez le guide !
Qu’est-ce que le métier de journaliste ? Quelles sont ses missions ?
Le métier de journaliste consiste avant tout à rechercher, vérifier et transmettre des informations de manière claire et objective. En pratique, le journaliste mène l’enquête sur le terrain ou auprès de ses sources, recoupe les faits, puis les restitue sous forme d’un article, d’un reportage radio/TV ou d’un contenu web. Sa mission est de tenir le public informé de ce qui se passe dans le monde, du niveau local au niveau international.
Concrètement, les tâches quotidiennes d’un journaliste peuvent inclure :
- La veille d’information – consulter en permanence les dépêches, les réseaux sociaux, les communiqués pour détecter les sujets d’actualité.
- La collecte d’informations – se rendre sur le terrain pour couvrir un événement, réaliser des interviews, rechercher des témoins, fouiller des documents.
- La rédaction ou la production – écrire des articles, enregistrer des reportages audio/vidéo, mettre en forme les informations de façon pédagogique et accrocheuse.
- La vérification et l’éthique – s’assurer de la fiabilité des sources, croiser les points de vue, respecter la déontologie (véracité, impartialité, etc.).
Quel que soit le média pour lequel il travaille (journal papier, site web, chaîne TV ou station de radio), le journaliste doit faire preuve de rigueur et d’objectivité. Son but : délivrer une information compréhensible et fiable au public. C’est un métier au service du citoyen, qui implique une grande responsabilité.
Découvrir le programme de la formation en communication peut également être une option pour acquérir des bases solides dans les médias et la rédaction.
💡 Exemple concret : Imaginez un journaliste local qui couvre un conseil municipal houleux. Le matin, il lit les ordres du jour (veille). Pendant la réunion, il prend des notes et interviewe le maire et des habitants (collecte d’infos). L’après-midi, il rédige son article, vérifie une statistique budgétaire auprès d’une source, et intègre une citation d’un riverain (rédaction et vérification). En fin de journée, son papier est relu par un collègue puis mis en ligne sur le site du journal.
Les différents métiers du journalisme : quels rôles peut-on exercer ?
Le terme “journaliste” recouvre en réalité une palette de métiers très variés. En fonction de vos affinités et de vos talents, vous pourrez vous orienter vers l’un ou l’autre de ces rôles :
- Journaliste de presse écrite : il rédige des articles pour des journaux ou magazines. Il peut être reporter (il enquête sur le terrain et écrit des reportages), chroniqueur (il tient une rubrique régulière, par ex. critique cinéma), ou localier (il couvre l’actualité d’une zone géographique précise pour un quotidien régional).
- Journaliste reporter d’images (JRI) : c’est le journaliste de télévision qui part sur le terrain avec sa caméra (ou son smartphone) pour tourner des images et réaliser des sujets complets pour le JT ou les magazines TV. Il cumule souvent les rôles de journaliste et de caméraman.
- Journaliste radio : spécialisé dans le média radio, il peut présenter les flashs infos, animer des émissions d’actualité ou réaliser des reportages diffusés à l’antenne. Sa voix est son outil principal, et il doit maîtriser l’art de raconter à l’oral de façon vivante.
- Journaliste web : il écrit pour des sites d’information en ligne. Ce “rédacteur web” doit savoir être concis, ajouter des liens hypertexte, des images ou vidéos, et penser au référencement SEO de ses articles. Souvent, il gère aussi la diffusion sur les réseaux sociaux.
- Présentateur / animateur : au JT de 20h, à la radio du matin ou dans un magazine télé, c’est le visage ou la voix qui incarne l’information. Le présentateur est un journaliste qui a développé une aisance pour parler au public, tout en préparant ses introductions et interviews.
- Éditorialiste : journaliste expérimenté, souvent spécialiste d’un domaine (politique, économie…), il donne son analyse et son point de vue dans des éditos ou des chroniques. Il apporte du recul et éclaire l’actualité par son expertise.
En plus de ces métiers de “terrain” ou de présentation, il existe des rôles clés en coulisses :
- Rédacteur en chef : il dirige la rédaction d’un média. C’est lui qui décide des sujets à traiter, de la “Une” du journal, qui répartit le travail aux journalistes et s’assure du respect de la ligne éditoriale. En télévision ou radio, on parle parfois de rédacteur en chef pour l’information, et de rédacteur en chef adjoint pour les aider.
- Secrétaire de rédaction (SR) : un métier moins connu du grand public. Le “SR” est un journaliste sédentaire qui relit et corrige les articles, reformule si nécessaire pour améliorer la clarté, vérifie l’orthographe des noms, les chiffres, etc. Il met en page l’article dans le journal. Un bon SR garantit une information de qualité et sans faute.
- Iconographe / Maquettiste : dans la presse magazine, l’iconographe choisit les photos qui accompagneront les textes, et le maquettiste conçoit la mise en page (placement des titres, colonnes, images) selon la charte graphique. Ce ne sont pas des “journalistes” au sens strict, mais ils travaillent en rédaction et souvent ont fait des études de journalisme ou de communication visuelle.
On pourrait encore citer d’autres profils comme le photojournaliste (photographe de presse indépendant ou employé, qui vend ses clichés aux journaux), le documentaliste (qui gère les archives et les ressources d’information d’un média), ou l’envoyé spécial (journaliste envoyé temporairement en mission sur un événement particulier, par exemple couvrir les Jeux Olympiques ou une zone de conflit pendant 2 mois).
🔎 À savoir : beaucoup de journalistes choisissent de se spécialiser par thématique au fil de leur carrière. Par exemple, devenir journaliste sportif, scientifique, politique, culturel, etc. Cette spécialisation permet de développer une véritable expertise et crédibilité dans un domaine (et souvent de la passion du journaliste pour son sujet). Il existe ainsi des “rubriques” dans les rédactions (rubrique Sport, rubrique Économie, rubrique International…) avec des chefs de rubrique et des journalistes attitrés.
Quelles études et formations pour devenir journaliste ?
Contrairement à certaines professions réglementées, il n’existe pas de “diplôme d’État” obligatoire pour exercer comme journaliste. En théorie, on peut devenir journaliste avec n’importe quel cursus, voire sans diplôme spécifique, si on parvient à faire ses preuves sur le terrain. MAIS en pratique, le secteur du journalisme est très concurrentiel et la majorité des nouveaux journalistes ont fait des études spécialisées. Il est fortement conseillé de viser au moins un niveau bac+3 à bac+5 pour mettre toutes les chances de votre côté.
Après le bac, plusieurs parcours d’études s’offrent à vous :
- Le chemin classique : écoles de journalisme ou Master – La France compte 14 écoles de journalisme reconnues par la profession (répertoriées par la CPNEJ). Parmi les plus célèbres : le CFJ (Centre de Formation des Journalistes) à Paris, l’ESJ Lille, l’IPJ Dauphine, le Celsa (Paris). Ces écoles recrutent sur concours après bac+2 ou bac+3, et forment en 2 ans à un niveau Master. Les diplômés de ces écoles ont un réseau et une formation très appréciés des rédactions. Alternativement, certaines universités proposent un Master professionnel en journalisme (bac+5) accessible sur dossier. L’entrée est sélective également. C’est le cas par exemple à l’IFP (Institut Français de Presse, Université Paris 2) ou à l’EPJT (Tours).
- La voie bac+3 professionnalisante – Il existe quelques cursus en 3 ans pour se lancer plus rapidement : le BUT Info-Com option Journalisme (en IUT, ex-DUT), ou des Licences professionnelles “Métiers du journalisme” (en 1 an après un bac+2 dans l’info-com ou les lettres). Par ailleurs, certaines écoles privées offrent un Bachelor Journalisme en 3 ans post-bac. Ces formations bac+3 donnent des bases pratiques solides et permettent d’intégrer le marché du travail, même s’il peut être pertinent ensuite de compléter avec un Master ou une spécialisation.
- Les autres parcours universitaires + spécialisation – De nombreux journalistes ont suivi un cursus classique dans un autre domaine puis bifurqué. Par exemple, faire une Licence en histoire, en science politique, en lettres, en droit ou en langue, puis présenter les concours des écoles de journalisme ou faire un Master journalisme. Cela permet d’avoir une double compétence. C’est un chemin courant : vous aurez ainsi une expertise de fond (sur l’histoire, la politique, etc.) en plus de vos compétences journalistiques.
En résumé, pour devenir journaliste, il est recommandé d’avoir au minimum une licence, et de préférence un Master. Le milieu est sélectif : un recruteur favorisera souvent un candidat qui sort d’une école reconnue ou qui a un bac+5, car cela démontre des compétences et des stages significatifs. D’ailleurs, les grands médias embauchent en priorité les diplômés des écoles reconnues. Cependant, comme ils le disent eux-mêmes, cela ne garantit pas un emploi stable immédiatement – la galère des débuts touche tout le monde.
🔎 Et le lycée ? Si vous êtes lycéen, aucune série n’est “obligatoire” pour faire journaliste. Mais certaines spécialités du bac général peuvent mieux vous préparer. Par exemple : Humanités, Littérature et Philosophie (HLP) pour améliorer votre culture générale et vos capacités d’analyse de textes – d’ailleurs, c’est une spécialité souvent conseillée pour ceux qui visent le journalisme ou l’enseignement. La spécialité Sciences Économiques et Sociales (SES) est également pertinente, car elle développe le regard critique sur la société, l’économie, la politique… ce qui nourrit un futur journaliste. Enfin, ne négligez pas les langues : la spécialité LLCER (anglais, espagnol…) ou l’option “Anglais monde contemporain” peuvent être utiles, car l’anglais est quasiment indispensable dans ce métier (pour consulter des sources internationales ou éventuellement travailler à l’étranger).
Bon à savoir : il existe aussi des formations courtes pour se familiariser avec le journalisme. Par exemple, certaines écoles proposent des stages d’été de 1 à 2 semaines pour lycéens curieux du métier. De même, des formations en ligne (MOOC) sur les bases du journalisme, ou des ateliers d’écriture journalistique dans certaines universités. Cela ne remplace pas un diplôme, mais peut conforter votre choix d’orientation.
Conseil :
Durant vos études supérieures, saisissez toutes les occasions pratiques : écrivez dans le journal étudiant, participez à des concours de reportages (par ex. le concours “Jeunes reporters”), faites des stages en rédaction dès que possible. Le journalisme est un métier où l’expérience de terrain et le réseau sont aussi importants que le diplôme. Un étudiant en Master qui a déjà plusieurs articles publiés et des contacts pro partira avec une longueur d’avance !
Quelles compétences faut-il pour être un bon journaliste ?
Passionné, curieux, tenace, polyvalent… Voilà quelques adjectifs qui reviennent pour décrire les qualités d’un journaliste. Ce métier requiert à la fois des compétences techniques solides et des qualités humaines marquées.
Compétences clés :
- Excellente maîtrise de la langue écrite et orale – Un journaliste doit savoir écrire sans fautes, structurer un récit, trouver les mots justes pour captiver l’attention. Un style clair et efficace est indispensable. De plus, une bonne élocution est nécessaire pour les formats audio/vidéo.
- Capacité de recherche et d’enquête – Savoir où chercher l’information, comment interroger une base de données, comment formuler les bonnes questions en interview… Le journaliste est un peu détective : il fouine, il creuse, il ne s’arrête pas à la première réponse. La rigueur méthodologique est cruciale.
- Culture générale étendue – Sans être expert de tout, il doit avoir des notions dans de nombreux domaines (histoire, politique, sciences, économie, culture générale…) pour mettre en perspective les nouvelles et poser les bonnes questions. Un journaliste qui couvre une actualité scientifique, par exemple, gagnera à comprendre les bases du sujet pour l’expliquer correctement.
- Maîtrise des outils numériques – Le journaliste 2025 sait utiliser un ordinateur sur le bout des doigts. Traitement de texte, mais aussi outils de montage (audio/vidéo), logiciels de publication web (CMS comme WordPress), réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok pour certains médias jeunes)… Le numérique fait partie intégrante du métier. Par exemple, un reporter radio doit savoir monter un son sur logiciel, un journaliste web doit connaître les rudiments du HTML et du SEO, etc.
- Organisation et gestion du temps – Avec les délais parfois très courts, il faut être capable de prioriser l’information, de travailler vite et bien. Savoir tenir une échéance est vital (ex: boucler un article pour 17h parce qu’à 18h il part à l’impression). Cela requiert sang-froid et sens de l’organisation.
Qualités personnelles :
- Curiosité insatiable – C’est le moteur n°1. Un bon journaliste s’intéresse à tout, tout le temps. Il a envie de comprendre ce qui lui est inconnu, d’aller vers les autres, d’apprendre en continu. Chaque sujet est l’occasion d’explorer de nouveaux horizons.
- Sens du contact et aisance relationnelle – Aller interviewer des inconnus, prendre la parole en public, nouer des liens de confiance avec des sources… Le journalisme est un métier de contact. Il faut aimer les rencontres et savoir communiquer facilement, s’adapter à toutes sortes d’interlocuteurs. La diplomatie et l’empathie sont de mise pour obtenir des confidences par exemple.
- Esprit critique et éthique – Le journaliste ne prend rien pour argent comptant. Il vérifie, il doute de la première version, il recoupe les informations. Cette capacité d’analyse critique est essentielle pour démêler le vrai du faux. Par ailleurs, une forte éthique personnelle est attendue : respecter la vérité, citer ses sources, ne pas céder aux pressions ou conflits d’intérêts. La crédibilité du journaliste en dépend.
- Résistance au stress et adaptabilité – Les imprévus sont fréquents : un événement de dernière minute peut bouleverser votre planning, un reportage peut s’avérer plus difficile que prévu… Il faut savoir garder son calme sous pression, rebondir face aux difficultés, faire preuve de flexibilité. Un jour vous êtes envoyé en urgence couvrir une manifestation, le lendemain vous devez remplacer un collègue au pied levé pour une présentation radio – il faut s’adapter rapidement.
- Persévérance et ténacité – Certaines enquêtes demandent des semaines d’efforts, des portes qui se ferment, des refus d’interview… Un journaliste déterminé ne lâche pas l’affaire facilement. C’est souvent cette ténacité qui permet de sortir un scoop là où d’autres auraient abandonné. Il faut aimer relever les défis et avoir le “nerf” nécessaire pour insister quand c’est important.
💡 Le saviez-vous ? En France, les journalistes adhèrent souvent à une Charte déontologique (la Charte de Munich, 1971) qui liste les devoirs du journaliste : respecter la vérité, corriger les erreurs, ne pas confondre information et publicité, protéger le secret des sources, etc. Cette charte résume l’éthique professionnelle attendue. Toute entorse (plagiat, fausse information, partialité excessive) nuit gravement à la réputation d’un journaliste.
Êtes-vous fait pour ce métier ? – Check-list rapide
- 📖 Vous adorez écrire et vous vous exprimez bien à l’écrit comme à l’oral.
- ❓ Vous êtes curieux(se) de tout : vous posez spontanément des questions, vous cherchez à comprendre les “pourquoi”.
- 💬 Vous êtes à l’aise avec les gens : parler à des inconnus ne vous fait pas peur, vous savez écouter attentivement.
- ⌚ Vous gérez le stress : vous travaillez efficacement même quand l’échéance est proche ou que la situation est tendue.
- 🕵️ Vous avez l’esprit critique : on ne vous la fait pas, vous aimez vérifier par vous-même les infos, recouper les versions.
Si vous vous reconnaissez dans ces points, alors le journalisme pourrait être taillé pour vous 😉.
Où travaillent les journalistes ? Presse, radio, TV, web…
Le secteur du journalisme s’exerce dans différents types de médias, chacun ayant ses particularités. Voici un tour d’horizon des principaux “univers” dans lesquels un journaliste peut évoluer :
Presse écrite (journaux, magazines)
C’est le support historique du journalisme. La presse écrite comprend :
- Les quotidiens – journaux publiés tous les jours (ex : Le Monde, Le Figaro, Libération au niveau national, ou des titres régionaux comme Ouest-France, La Montagne…). Ils couvrent l’actualité générale. Travailler pour un “quotidien national” nécessite souvent de l’expérience et une grosse capacité de synthèse, alors qu’un “quotidien régional” implique d’être très proche du terrain local.
- Les hebdomadaires – magazines d’actualité ou spécialisés, publiés chaque semaine (ex : L’Obs, Le Canard Enchaîné, L’Équipe Magazine). Les journalistes y ont un peu plus de temps pour approfondir leurs sujets qu’en quotidien.
- Les mensuels et magazines spécialisés – revues publiées chaque mois ou trimestriellement, souvent centrées sur un thème (science, art de vivre, économie, mode, musique, etc.). Les journalistes “presse magazine” peuvent se spécialiser dans un domaine pointu (ex: journaliste automobile, journaliste high-tech pour un mag de jeux vidéo…). Ce sont parfois des niches très passionnantes.
La presse écrite représente encore aujourd’hui une large part des emplois journalistiques en France (y compris via les sites web associés aux journaux). Cependant, c’est un secteur en mutation du fait de la baisse des tirages papier. Beaucoup de journaux se sont convertis au numérique avec des rédactions web dédiées.
Exemple de débouché : la PQR (Presse Quotidienne Régionale) est souvent citée comme un employeur de jeunes journalistes. Les journaux régionaux ont besoin de sang neuf pour couvrir le terrain. Travailler dans un quotidien régional implique souvent de déménager dans la région en question. L’avantage : on touche à tout (sport local, faits divers, vie municipale…) et on gagne vite en autonomie. L’inconvénient : ce n’est pas toujours dans de grandes métropoles “rêvées”, il faut accepter de débuter, par exemple, dans une petite ville en tant que correspondant local.
Agences de presse
Les agences de presse (AFP, Reuters, AP…) sont des structures qui collectent l’information et la redistribuent aux médias. Un journaliste d’agence travaille très souvent “au desk” : c’est-à-dire qu’il reçoit des dépêches de correspondants du monde entier, les vérifie, les réécrit si besoin en style neutre, et les envoie aux abonnés de l’agence (qui sont les rédactions). C’est un travail intense, sur le fil de l’actualité en continu.
Les agences ont aussi des reporters sur le terrain, mais globalement c’est un milieu assez réduit en nombre d’emplois. Intégrer l’AFP, par exemple, est très valorisant mais très compétitif. Les journalistes d’agence doivent être ultra-réactifs et précis, car ce sont eux qui fournissent l’info brute que tout le monde va reprendre.
Radio
“À la radio, l’info va vite” pourrait être le slogan. La radio est le média de l’immédiateté : s’il se passe quelque chose d’important dans le monde, une station de radio interrompt sa musique pour un flash spécial. Être journaliste radio, c’est aimer l’adrénaline du direct et le pouvoir des mots (sans l’image). Au sein d’une station, on trouve :
- Des rédacteurs-présentateurs – ils écrivent et lisent les bulletins d’information. Par exemple le matin à 7h ou 8h, ils présentent les nouvelles nationales/internationales en 3 minutes. Ils doivent avoir une diction impeccable et la capacité de condenser beaucoup d’infos en peu de temps.
- Des reporters radio – sur le terrain, ils réalisent des micro-trottoirs, des interviews sonores, qu’ils montent ensuite pour diffusion. Ils peuvent aussi intervenir en direct par téléphone depuis le lieu d’un événement.
- Des animateurs-journalistes – notamment en radio locale, la frontière entre animateur et journaliste est fine. Ils présentent des magazines d’info avec invités, gèrent l’antenne tout en informant (ex: la radio du trafic routier, etc.).
La radio offre souvent leur première chance aux jeunes journalistes, via des contrats précaires (beaucoup commencent en contrat aidé ou en pige dans des radios associatives ou locales). Ce n’est pas un secteur très rémunérateur en début de carrière, mais il a l’avantage de la proximité avec l’audience et de la formation à l’école du direct.
À noter : un journaliste radio doit maîtriser des compétences spécifiques comme le montage audio (découper/rassembler des séquences sonores) et le voix-off (poser sa voix de manière expressive mais compréhensible).
Télévision
La télévision est souvent perçue comme le graal par certains, en raison de la visibilité offerte. Les métiers du journalisme à la TV sont multiples :
- Journaliste reporter d’images (JRI) – on en a parlé, il part sur le terrain filmer et interviewer, puis monte son sujet. À la télé régionale de France 3 par exemple, les JRI font presque tout eux-mêmes (prises de vue, interview, commentaires).
- Présentateur / présentatrice – que ce soit du JT ou d’une émission de reportage, c’est un rôle très en vue. Souvent ils ont gravi les échelons comme reporters avant d’accéder au poste “plateau”. Le présentateur doit savoir écrire ses lancements (les textes qui introduisent les reportages) et mener des interviews en direct avec aisance.
- Rédacteur en rédaction TV – toutes les infos ne nécessitent pas d’envoyer une équipe sur le terrain. En rédaction, des journalistes “sédentaires” récupèrent par exemple les images d’agence ou les vidéos envoyées par correspondants, et rédigent des brèves ou synthèses qui seront lues à l’antenne. Ce sont un peu les équivalents des rédacteurs presse écrite, mais pour la télé.
- Chef d’édition – dans un journal télévisé, il y a un journaliste qui coordonne tout le conducteur de l’émission. C’est lui le chef d’orchestre en régie, qui décide à la seconde près de l’enchaînement des sujets, en lien avec le rédacteur en chef. Un travail de l’ombre crucial.
La télévision étant un média de masse, c’est là qu’on trouve les plus grandes rédactions en effectif. Par exemple, le JT de 20h d’une grande chaîne mobilise des dizaines de journalistes (correspondants dans chaque pays pour l’international, spécialistes santé, météo, économie, etc.).
Pour un jeune journaliste, percer à la télévision peut prendre du temps. Souvent, on commence en région (par ex. France 3 Régions), ou sur des chaînes locales / webTV, puis on évolue si possible vers le national. Avec l’explosion des chaînes d’info en continu (BFM, CNews, LCI, Franceinfo), des opportunités se sont créées ces dernières années pour les nouveaux journalistes, notamment comme JRI ou comme rédacteurs.
Médias numériques et nouveaux formats
Enfin, impossible de parler des secteurs du journalisme sans évoquer le web et les nouveaux médias. Presque tous les journalistes aujourd’hui travaillent aussi pour Internet, ne serait-ce que parce que leur article de presse écrite finit en ligne. Mais certains médias sont purement numériques : sites d’info en ligne (Mediapart, HuffPost, 20 Minutes en ligne, etc.), chaînes YouTube d’actualité, podcasts natifs (comme Louie Media ou Transfert).
Le journaliste web doit maîtriser les codes spécifiques : l’instantanéité (live-tweet, direct commenté), le référencement Google, l’interactivité (intégrer les réactions des lecteurs, utiliser les formats innovants). Des métiers spécialisés ont émergé :
- Community Manager éditorial – il gère la présence du média sur les réseaux sociaux, publie les articles sur Facebook/Twitter, répond aux commentaires, peut modérer les discussions. Ce rôle est souvent confié à de jeunes journalistes familiarisés avec ces plateformes.
- Datajournaliste – mi-développeur mi-journaliste, il sait manipuler des bases de données, programmer des scripts pour extraire de l’info de milliers de pages, et créer des visualisations (graphiques interactifs par ex.). Ce profil est très recherché dans les grands médias pour traiter des sujets complexes de manière innovante.
- Journaliste multimédia – capable à la fois d’écrire un article, de prendre des photos et de tourner/monter une courte vidéo pour les réseaux. Cette polyvalence, autrefois rare, devient un standard demandé notamment dans les rédactions web à effectifs réduits.
➡️ Opportunité : le web offre aussi la possibilité aux jeunes journalistes de créer leur propre média plus facilement qu’avant. Par exemple, lancer une newsletter thématique payante, un blog d’analyse, ou une chaîne vidéo. Certains journalistes indépendants parviennent ainsi à vivre de leurs contenus en s’adressant directement au public (via des abonnements, du financement participatif…). C’est encore minoritaire, mais c’est une piste de carrière qui n’existait pas il y a 15 ans.
Entrer dans le journalisme : comment faire et quelles difficultés au début ?
La question qui fâche parfois : “Est-il difficile de trouver un travail dans le journalisme ?” Honnêtement, oui, c’est un secteur compétitif. Voici ce qu’il faut savoir sur les débuts de carrière :
Un marché du travail saturé ?
Chaque année, les écoles diplôment des centaines de journalistes, sans compter tous ceux qui arrivent par d’autres filières. Or les médias traditionnels ne créent pas des postes au même rythme – au contraire, on a plutôt assisté ces dernières décennies à des réductions d’effectifs dans certains journaux. Résultat : beaucoup de candidats pour peu d’élus. Les grands médias nationaux reçoivent d’innombrables CV pour chaque offre.
Toutefois, il y a des opportunités : dans la presse locale, dans les nouveaux médias en ligne, dans la presse spécialisée, on recrute régulièrement de jeunes journalistes. Cela implique souvent de commencer par des contrats précaires :
- Les piges – statut de freelance. Vous vendez un article à l’unité à un journal ou magazine. Par exemple, un pigiste peut écrire pour 3 magazines différents en même temps. Payé “à la ligne” ou au feuillet, c’est une vie incertaine mais qui permet de faire ses preuves. Beaucoup débutent en pigiste.
- Les CDD de remplacement – un journal dont un rédacteur part en congé maternité va prendre un CDD 6 mois; l’été, les rédactions embauchent des remplaçants pour couvrir les vacances. Ce sont des occasions d’intégrer temporairement une équipe.
- L’alternance / apprentissage – de plus en plus d’écoles et de médias jouent le jeu de l’apprentissage. Pendant vos études (2e ou 3e année généralement), vous travaillez en rédaction 3 jours par semaine et allez en cours le reste du temps. C’est un pied dans la porte : si vous faites vos preuves, le média pourra vous embaucher ensuite.
Il est fréquent qu’un jeune journaliste mette 2 à 3 ans après l’obtention de son diplôme pour décrocher un CDI. C’est une période où il faut s’accrocher, accepter une vie un peu instable. Selon les stats de la profession, environ 1 journaliste sur 5 est pigiste “permanent” (certains par choix, d’autres faute de poste fixe). D’ailleurs, ces dernières années, la part des pigistes a explosé parmi les entrants : près de 70% des nouveaux journalistes débutent en piges, contre à peine 25% en CDI (les rares qui décrochent un CDI jeune sont souvent passés par l’alternance ou sortent major d’une grande école).
20002023CDI 65%CDI 26%Pigiste 35%Pigiste 68%
📊 En 2000, la majorité des jeunes journalistes entraient en CDI.
En 2023, la très grande majorité débute en pigiste (freelance).
(Graphique indicatif basé sur les données de la Commission de la Carte de Presse : en 2000, 65,8% des premières demandes de carte étaient pour des CDI; en 2023, ce chiffre n’est plus que 25,8%, les pigistes étant 68%.)
Conseils pour s’insérer :
Malgré ces difficultés, de nombreux jeunes parviennent chaque année à intégrer la profession. Voici quelques conseils concrets :
- Profitez de vos stages et alternances – Ce sont souvent des tremplins vers l’emploi. Montrez de l’enthousiasme, proposez des sujets, créez du lien avec l’équipe. Il n’est pas rare qu’un stagiaire performant soit rappelé plus tard pour un job.
- Constituez-vous un réseau – En journalisme plus qu’ailleurs, le réseau est clé. Gardez contact avec vos camarades de promo (certains seront embauchés ici ou là, et pourront vous recommander), avec vos profs (souvent des pros du milieu), avec des journalistes croisés en événement. Sans être opportuniste, soyez présent sur LinkedIn, Twitter en tant que futur journaliste, participez à des rencontres métiers.
- Créez votre portfolio – Dès que vous avez réalisé quelques articles, même étudiants, mettez-les en valeur. Par exemple, créez un blog ou un site personnel où vous présentez vos meilleurs travaux (articles PDF, liens vers vidéos radio que vous avez faites, etc.). Les recruteurs apprécient de voir concrètement ce que vous savez faire.
- Ne visez pas seulement “TF1 20h” dès le début – Soyez stratégiques et modestes dans vos débuts. Candidater dans des petites rédactions, dans la presse spécialisée, dans une radio locale, peut vous offrir votre première expérience. Par la suite, il sera plus facile de viser plus haut. Mais si vous attendez le poste parfait dès le départ, vous risquez de perdre du temps.
- Envisagez le plurimedia et la pige – Parfois, il faut cumuler plusieurs petites collaborations pour en vivre. Exemple : écrire quelques papiers pour un site web sportif + faire des chroniques bénévoles sur une web radio + tenir un blog perso très suivi. Cela peut sembler décousu, mais toutes ces expériences mises bout à bout construisent votre réputation et vos compétences.
Un jeune journaliste sur Reddit résumait bien l’état d’esprit à avoir : “Les gens vraiment attirés par ce domaine restent. Malgré tout ce qu’on entend sur la crise des médias, il y aura toujours besoin d’info. Si ça ne marche pas immédiatement, il y a des plans B en communication, mais il faut tenter sa chance si c’est votre passion.” En clair : armez-vous de patience et de persévérance, et n’oubliez pas pourquoi vous avez voulu faire ce métier !
Salaire d’un journaliste débutant et évolution de carrière
Parlons rémunération – un sujet important pour planifier votre avenir. Il faut être honnête : les journalistes ne font pas partie des professions les mieux payées à qualification équivalente, surtout en début de carrière. Cependant, avec l’expérience et en gravissant les échelons, la situation s’améliore sensiblement pour certains.
Salaire en début de carrière
En débutant, un journaliste junior gagne autour de 1 800 € brut par mois (environ 1 400 € net) s’il est embauché en CDD ou CDI dans une rédaction moyenne. Cela peut varier :
- Dans une petite radio locale ou un journal local, un débutant sera souvent au SMIC ou à peine plus (1 350-1 400 € net).
- Dans un média national ou un grand magazine parisien, un débutant pourra tourner autour de 2 000 € net (ce qui correspondrait à ~2 600 € brut).
- En piges, c’est très variable : un article de 1 page dans un mensuel peut être payé 150 €, un reportage d’une journée pour un site web peut rapporter 100 €, etc. Un pigiste très actif peut gagner 1 500 à 2 000 € net par mois, mais sans garantie du mois suivant.
Selon les données 2025 (source 1001interims), le salaire d’un journaliste débutant se situe généralement entre 2 000 € et 2 800 € brut par mois (soit ~1 600 € à 2 200 € net). Les échelons de salaire sont souvent calqués sur la Convention collective nationale de travail des journalistes, qui prévoit un minimum selon la qualification et l’ancienneté.
👛 Astuces finances : les journalistes bénéficient en France d’un abattement fiscal (environ 7 650 € par an en 2023) sur leur impôt sur le revenu, censé compenser les frais liés à la profession (achat de journaux, déplacements non remboursés…). Concrètement, cela veut dire qu’à salaire égal, un journaliste paie un peu moins d’impôts qu’un autre cadre, ce qui améliore légèrement son revenu net disponible. C’est bon à savoir même si ça ne change pas radicalement la donne.
Évolution avec l’expérience
Avec quelques années d’expérience, si vous parvenez à décrocher un poste stable, vous deviendrez journaliste confirmé. Au bout de 5 à 10 ans, un journaliste en CDI dans une grande rédaction peut gagner entre 3 000 € et 4 500 € brut par mois (2 400 à 3 500 € net). La fourchette est large car tout dépend du média et du poste :
- Dans la presse régionale, un rédacteur avec 10 ans d’expérience sera peut-être autour de 2 500 € net/mois.
- Dans un hebdo national réputé ou un site web à succès, ça peut monter à 3 000-3 500 € net.
- A la télévision nationale, les salaires sont en moyenne plus élevés que dans la presse écrite (car les moyens financiers des chaînes sont plus importants). Un reporter expérimenté de France Télévisions ou TF1 peut être autour de 4 000 € net.
Ensuite, en devenant rédacteur en chef ou en prenant des fonctions d’encadrement, on continue de grimper. Un rédacteur en chef adjoint dans un quotidien national pourrait être à 5 000 € brut, un rédacteur en chef à 6 000-7 000 € brut, etc. Les “stars” du journalisme, comme certains présentateurs vedettes de JT ou animateurs télé très connus, atteignent des niveaux de salaire bien plus élevés (plusieurs dizaines de milliers d’euros mensuels parfois). Mais il s’agit d’exceptions très médiatisées et cela ne reflète pas la majorité.
💡 Évolution de carrière : Outre l’aspect financier, évoluer en interne signifie souvent passer de “celui qui exécute” à “celui qui décide et encadre”. Après plusieurs années, un journaliste peut devenir chef de service ou chef de rubrique (responsable d’une équipe sur un domaine précis). Par exemple, “chef de rubrique Culture” dans un magazine : il coordonne les journalistes culture, choisit quels sujets traiter, etc. De fil en aiguille, il peut monter rédacteur en chef adjoint, puis rédacteur en chef. Cette progression n’est pas automatique ni systématique – certains journalistes préfèrent rester reporteurs toute leur vie parce que c’est ce qui les passionne, plutôt que de manager. D’autres au contraire embrassent des postes de direction éditoriale, voire de direction de médias à la fin de leur carrière.
Reconversion et mobilité : il est aussi assez fréquent qu’en milieu de carrière (après 10-15 ans), des journalistes partent vers d’autres horizons. Certains deviennent rédacteurs SEO / content managers dans des entreprises, d’autres intègrent des services de communication (attachés de presse, responsables com’ dans de grandes institutions ou entreprises), d’autres encore écrivent des livres ou deviennent professeurs (par ex. enseignants en école de journalisme ou consultants médias). La palette de compétences acquises (excellente expression écrite, esprit de synthèse, réseaux de contacts, connaissance des médias) est très valorisable dans beaucoup de domaines.
Avantages et défis du métier de journaliste
On dit souvent que le journalisme est un métier vocation. Qu’est-ce qui fait rêver dans ce métier, et à l’inverse, qu’est-ce qui peut le rendre difficile au quotidien ? Faisons le point.
✅ Les grands côtés positifs :
- Un métier passionnant et varié – Vous ne connaîtrez pas la routine. Chaque jour apporte son lot de surprises. Vous traitez des sujets toujours différents, rencontrez des personnes aux parcours variés (du ministre à l’agriculteur du coin, de la star de cinéma au scientifique pointu). Si vous êtes curieux, vous serez comblé, car vous apprenez en continu. Nombre de journalistes disent qu’ils ne pourraient pas supporter un boulot monotone, et qu’ils aiment profondément l’adrénaline et la diversité de leur métier.
- Le sentiment d’être utile – Informer, c’est essentiel en démocratie. En dévoilant des faits, en donnant la parole, vous contribuez (à votre échelle) à faire évoluer les choses. Beaucoup tirent fierté d’avoir, par exemple, écrit un article qui a alerté sur une injustice, ou d’avoir aidé le public à mieux comprendre un enjeu compliqué. C’est gratifiant.
- Des expériences uniques – Certains journalistes ont l’opportunité de voyager loin, de couvrir des événements historiques (élections, sommets internationaux, guerres, etc.), de vivre des moments très forts. Même au niveau local, vous pouvez vous retrouver à monter dans un hélicoptère de la sécurité civile pour un reportage, ou à suivre les coulisses d’un concert géant… Ce métier ouvre des portes exceptionnelles. “On a la meilleure place, mais on ne fait pas partie du spectacle” résument certains reporters.
- Des rencontres marquantes – Le carnet d’adresses d’un journaliste peut ressembler à un “bottin mondain” ou un inventaire à la Prévert. On peut interviewer un jour un grand chef étoilé, le lendemain un rescapé d’une catastrophe, la semaine suivante un chercheur Nobel. Chaque rencontre enrichit humainement. Beaucoup de journalistes disent apprendre des autres en permanence.
- Une certaine liberté créative – Notamment si vous êtes dans un média où l’on vous fait confiance, vous pouvez proposer vos propres sujets, votre propre angle. Écrire un article, c’est aussi une création intellectuelle, il y a une part de style personnel. Cette liberté d’expression (dans le respect des faits) est appréciable. Par rapport à un travail très encadré hiérarchiquement, un journaliste a souvent plus de marge de manœuvre sur la manière de mener son travail.
💬 Témoignage positif : “Ce métier est fou : j’ai couvert la Coupe du Monde de football, j’ai dormi chez l’habitant dans un village reculé pour un reportage, j’ai assisté à des défilés de mode de luxe, j’ai rencontré des gens incroyables… On vit mille vies en une seule !” confie Sarah, journaliste depuis 15 ans. Ce genre d’enthousiasme est fréquent chez ceux qui ont la flamme journalistique.
⚠️ Les aspects difficiles :
- Des horaires et un rythme de vie exigeants – On l’a évoqué : soirées, week-ends, nuits blanches occasionnelles… font partie du métier. Il faut accepter d’être “toujours branché”. Difficile de vraiment déconnecter, surtout à l’ère du smartphone (les rédactions envoient des notifications push, etc.). Cela peut peser sur la vie personnelle. Les journalistes font partie des professions où il peut être dur de concilier vie de famille et travail, notamment pour ceux qui voyagent beaucoup ou ceux en horaires décalés (matinaliers radio, etc.).
- La précarité des premières années – Gagner 1200 € net en pigeant à 25 ans alors qu’on a bac+5… c’est malheureusement une réalité pour certains. Il faut souvent plusieurs années avant de stabiliser sa situation financière. Cette incertitude (vais-je avoir assez d’articles ce mois-ci ? Mon CDD va-t-il être renouvelé ?) est stressante. Beaucoup de jeunes journalistes voient leurs amis d’autres filières obtenir des CDI et un meilleur salaire plus vite, ce qui peut être démoralisant à court terme.
- La pression de l’information en continu – Avec les chaînes d’info H24 et Internet, il faut être très réactif. Parfois au détriment du recul et de l’analyse. Les journalistes se plaignent d’avoir moins de temps qu’avant pour approfondir. Il y a aussi la pression de l’audience et du clic (surtout en ligne), qui peut imposer de traiter des sujets “qui font du buzz” plutôt que des sujets de fond. Cette logique peut être frustrante pour ceux qui aiment la profondeur.
- La remise en question permanente – Les médias sont très critiqués. “Les journalistes mentent”, “les médias sont vendus”, etc. sont des discours qu’on entend (parfois injustement généralisés). Travailler en tant que journaliste aujourd’hui, c’est accepter cette défiance d’une partie du public. Sur les réseaux sociaux, les journalistes (notamment femmes) peuvent subir du harcèlement, des insultes. Il faut avoir le cuir épais.
- Des risques selon les sujets – Pour les reporters de guerre ou ceux qui enquêtent sur le crime organisé, la corruption, etc., il existe de vrais dangers physiques ou juridiques. Ce sont des cas particuliers, mais il faut savoir que certains journalistes mettent leur vie ou leur tranquillité en péril pour faire leur travail (menaces, agressions lors de reportages de rue, etc. – on l’a vu pendant certaines manifestations).
En somme, le journalisme est un métier exaltant mais qui demande des sacrifices personnels. C’est un choix de vie autant qu’un choix de carrière. Ceux qui s’y épanouissent sont généralement des passionnés pour qui ces défis sont surmontables. À l’inverse, si l’on cherche avant tout un confort matériel et une stabilité horaire, on risque d’être déçu.
💡 Conseil bien-être : De plus en plus, on encourage les journalistes (comme dans d’autres métiers stressants) à surveiller leur équilibre de vie. Faire du sport, avoir des hobbies en dehors du boulot, déconnecter de l’info de temps en temps pour éviter le burn-out, etc. Ce n’est pas toujours facile, mais c’est important pour tenir dans la durée.
L’impact du numérique sur les métiers du journalisme
En l’espace de 20 ans, le numérique a transformé profondément les pratiques journalistiques. On parle aujourd’hui de journalisme 2.0 pour désigner ce nouveau visage du métier à l’heure d’Internet et des réseaux sociaux.
Nouvelles façons de travailler
Autrefois, un journaliste écrivait son article, et le lecteur le découvrait le lendemain dans le journal. Point. Maintenant, l’article est mis en ligne immédiatement, mis à jour en temps réel, partagé sur Facebook, commenté sur Twitter… Le journaliste doit souvent interagir avec son public. Les lecteurs peuvent réagir directement, l’information circule plus horizontalement. Cela demande au journaliste d’être présent sur ces plateformes, de comprendre les codes (un titre accrocheur pour Facebook, un format thread sur Twitter, etc.).
Le numérique apporte aussi une foule d’outils très utiles :
- Recherche d’info facilitée – Internet est une mine de données pour les journalistes : on peut accéder à des documents officiels en ligne, consulter des bases de données publiques, retrouver d’anciens articles en quelques clics. La contrepartie est qu’il faut trier le vrai du faux dans ce flot d’infos (d’où l’essor du fact-checking).
- Outils de production plus rapides – Un journaliste peut envoyer son article depuis son ordinateur portable en déplacement, filmer avec son smartphone et diffuser instantanément une vidéo en direct (Facebook Live, Periscope…). Cela permet de couvrir l’actualité très vite, sans attendre le journal du soir. Le revers est que cela accentue la pression pour sortir l’info en premier.
- Plurimédia – Un même journaliste peut écrire un article, puis enregistrer un podcast de décryptage du même sujet, et faire une vidéo courte pour les réseaux. Cette polyvalence est rendue possible par les outils numériques (logiciels de montage à la portée de tous, plateformes de publication en un clic). Mais cela signifie aussi que la frontière entre les postes se brouille.
Nouveaux métiers émergents
Nous avons évoqué plus haut certains nouveaux profils très demandés : Data-journaliste, community manager, journaliste mobile… Par ailleurs, des startups de médias en ligne ont vu le jour, avec des formats innovants (pure-players comme Brut qui fait de la vidéo pensée pour le mobile, Konbini etc.). Ces entreprises recrutent des journalistes d’un genre nouveau, souvent très jeunes et à l’aise avec les codes visuels modernes, parfois avec des compétences en motion design ou en code. C’est une évolution passionnante car le journalisme s’y réinvente.
Le phénomène des journalistes “entrepreneurs” : aujourd’hui, un journaliste peut plus facilement se mettre à son compte grâce au web. Par exemple, lancer une newsletter sur Substack et en vivre via les abonnements, créer un média YouTube monétisé par la publicité, ou animer un podcast sponsorisé. Ce sont des voies de niche, mais quelques-uns réussissent très bien. Cela demande non seulement des compétences rédactionnelles, mais aussi de savoir se vendre, créer une communauté, etc. On voit apparaître la notion de “journaliste-marque” (un journaliste qui a lui-même des milliers d’abonnés qui le suivent indépendamment du média pour lequel il travaille). C’est un changement de paradigme intéressant dans la profession.
Intelligence artificielle et futur du journalisme
Un point crucial pour l’avenir : l’intelligence artificielle (IA). Des IA sont déjà capables de rédiger automatiquement de courtes dépêches (par ex, des résultats sportifs, des brèves financières basiques). De quoi inquiéter certains journalistes… Toutefois, l’IA peut aussi être un outil formidable pour les aider : analyser rapidement un gros document à la recherche d’informations clés, générer des transcriptions d’interviews, suggérer des angles via l’analyse des tendances sur les réseaux, etc.
La profession suit de près ces évolutions. Il est probable que les journalistes de demain devront intégrer l’IA dans leur boîte à outils. Mais le cœur du métier – la créativité, le jugement humain, l’enquête de terrain – restera difficile à automatiser. L’IA pourra délester les journalistes des tâches fastidieuses (transcription, tri de données), les laissant se concentrer sur la vérification, l’analyse fine et le contact humain.
➡️ En résumé, le numérique représente à la fois un défi et une opportunité : défi car il faut sans cesse se former et s’adapter, opportunité car il a élargi le champ du possible et ouvert de nouvelles carrières. Les jeunes journalistes actuels n’ont jamais connu le monde sans Internet : ils sont donc généralement à l’aise avec ces outils et en feront les médias de demain. Si vous embrassez ce métier, préparez-vous à évoluer en permanence et à apprendre de nouvelles compétences tout au long de votre parcours.
Conclusion
Le journalisme est plus qu’un métier : c’est une véritable aventure humaine et intellectuelle. Devenir journaliste demande du travail, de la persévérance et une bonne dose de passion – mais pour ceux qui ont “la flamme”, les récompenses non matérielles sont immenses. Informer, raconter le réel, donner la parole à ceux qui ne l’ont pas, vivre des moments hors du commun : voilà ce qui attend les aspirants journalistes.
Dans ce guide, nous avons exploré les multiples facettes des métiers du journalisme : de la presse écrite à la télé, des études aux compétences requises, des joies aux difficultés. Si ce métier vous attire, retenez qu’il n’y a pas de chemin unique pour y parvenir. Que vous passiez par une grande école ou par une petite porte locale, c’est votre détermination et votre curiosité qui feront la différence sur le long terme.
Alors, prêt(e) à “prendre la plume” ou le micro ? N’hésitez pas à consulter notre guide d’orientation des lycéens pour bien choisir vos premières étapes vers le journalisme. Et découvrez aussi d’autres carrières liées sur Pass-Éducation, comme le métier de rédacteur web SEO ou celui d’attaché de presse, pour élargir vos horizons.
Quel que soit votre chemin, gardez en tête la devise de nombreux journalistes : “Chercher la vérité, coûte que coûte.” C’est cette quête qui fait la noblesse du journalisme. Bonne route vers les salles de rédaction de demain !



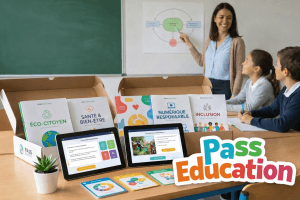


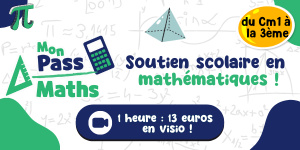

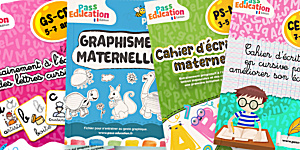
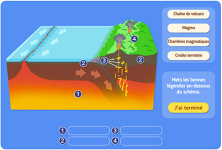

Commentaires